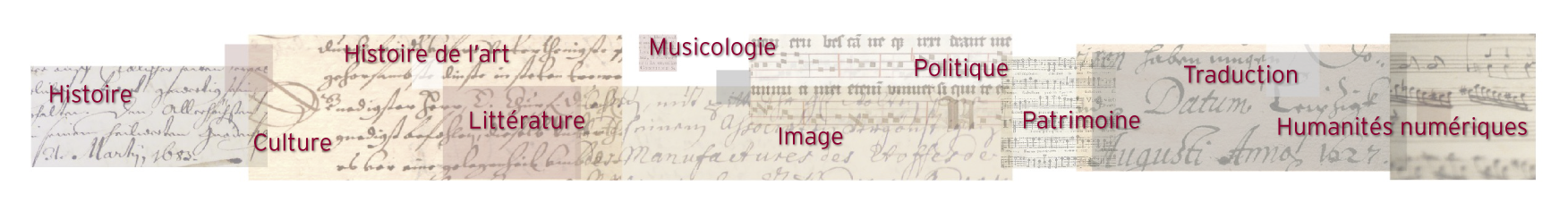Colloque international à l’occasion du troisième centenaire de la parution du
Maître à danser de Pierre Rameau (1725)
International conference
Celebrating the 300th anniversary of the publication of “Le Maître à danser” by Pierre Rameau (1725)
« Enseigner la manière » Les traités techniques de danse (1700-1750)
“Teaching the Manner of Performing all Steps…”
The Technical Dance Treatises (1700-1750)
11 et 12 décembre 2025 – 11 and 12 December 2025
Paris, Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret (Fondation Royaumont)
(English version below)
L’année 2025 verra le tricentenaire de la publication d’un ouvrage majeur pour la connaissance de la danse du XVIIIe siècle : Le maître à danser. Qui enseigne la manière de faire tous les différens pas de danse dans toute la régularité de l’art, & de conduire les bras à chaque pas, de Pierre Rameau (1674-1748). Ce dernier publie également à la même époque son Abbregé de la nouvelle methode, dans l’art d’ecrire ou de traçer toutes sortes de danses de ville. Le Maître à danser connut une diffusion importante, réédité plusieurs fois jusqu’en 1748, traduit en anglais en 1728 par John Essex et adapté en espagnol par Ferriol. Il eut une grande influence sur de nombreuses publications ultérieures, en France et à l’étranger, qu’il s’agisse de traités sur la technique française ou d’articles sur la danse dans les encyclopédies et les dictionnaires. Il est aujourd’hui considéré comme l’une des sources centrales pour l’essor de la danse baroque.
L’anniversaire de cette publication nous convie à revenir sur l’histoire et le contenu du Maître à danser, mais plus encore sur les enjeux de son élaboration en son temps, en le situant plus généralement dans l’histoire des traités à visée technique sur la danse dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il s’agit aussi de faire le point sur les pratiques dont il porte la trace, à la lumière des dernières recherches. L’objectif de ce colloque est donc double : mieux cerner la portée de l’ouvrage au XVIIIe siècle, et ses effets sur les pratiques actuelles de la danse ancienne.
Un premier axe du colloque portera sur le contexte historique et social du Maître à danser. Les principaux jalons de la vie et de la carrière de Pierre Rameau, actif à Lyon, à Strasbourg et à Paris, ainsi que les aspects prosopographiques, ont déjà été scrutés, mais il reste à mieux connaître sa pratique de maître à danser, ses élèves, les contextes de son enseignement. L’étude des exemplaires conservés dans les principales bibliothèques, mais aussi l’analyse du projet didactique déployé par Rameau dans ses traités permettent de renouveler et d’approfondir différents questionnements : qui furent les lecteurs et surtout les utilisateurs des ouvrages de Pierre Rameau ? Dans quels contextes pédagogiques furent-ils utilisés ? Que pouvaient apporter les textes et les images des traités de Rameau à la pratique des danseurs et des honnêtes gens du XVIIIe siècle ? L’apprentissage des bonnes manières et de la civilité, qui occupe plusieurs chapitres de l’ouvrage, mérite d’être approfondi et mis en regard avec d’autres sources, afin de mieux comprendre ses modalités d’application.
Un deuxième axe du colloque s’intéressera à l’exposition de la technique par Pierre Rameau. Si les dimensions morales, apologétiques, génériques ou esthétiques des traités de danse ont fait l’objet de plusieurs études, c’est moins le cas pour ce qui constitue leur spécificité : un texte orienté vers la description ou la prescription du mouvement dansé. Dans cet objet insaisissable, c’est la combinaison complexe et instantanée d’éléments hétérogènes (espace, temps, énergie, poids…) qu’il faut saisir. Selon quels procédés et par quels moyens, le mouvement, son continuum et la synthèse qu’il opère entre ses paramètres sont-ils consignés, organisés, réglés, réduits ou au contraire surdéterminés ? En quoi consiste la production d’un texte chorégraphique technique, une mise en mot d’actions mais aussi d’intentions et de qualités ? En quoi cela témoigne-t-il d’une approche globale, systématique, de la danse et de sa transmission ? Dans quelle mesure le choix d’une méthode, d’une “manière d’enseigner la danse” est-elle révélatrice d’une analyse, d’une compréhension voire d’une pensée du mouvement ? Quels liens peut-on établir avec les systèmes contemporains de notation de la danse ? Quelles connaissances musicales manifestent ces enseignements, et quels sont leurs rapports avec les pratiques, les théories et les répertoires musicaux qui leur sont contemporains ? Quels critères président aux choix d’exemples musicaux et chorégraphiques ? Comment les traités témoignent-ils de perceptions historiques ou particulières du corps, de l’espace et du temps, ainsi que des savoirs anatomiques, physiques et physiologiques, géométriques, et plus généralement des courants de pensée du premier XVIIIe siècle ? Autre point essentiel pour la compréhension de ce type de source : quels sont les sous-entendus et les non-dits d’un traité technique, qui peut passer sous silence ce que tout le monde sait ou voit à l’époque ? Comment exhumer ces implicites, ces évidences de pratiques oubliées ? Plus généralement, quelles conceptions de la danse véhiculent les textes techniques, en relation notamment à sa fonction, à ce que danser veut dire dans une culture du corps qui soutient une représentation de soi ? En quoi le traité technique est-il porteur de normes mais aussi d’innovations, et comment peut-il proposer, au-delà d’objets définis, des processus de composition, et des latitudes d’interprétation ?
Un troisième axe replacera la démarche de Rameau dans un ensemble plus vaste, celui d’une production nouvelle d’ouvrages dédiés à la pratique de la danse dans tout l’espace européen, sous forme de notations, mais plus encore de traités consacrés à l’exécution des danses de bal, et plus particulièrement des “danses de ville”, avant que les traités ne basculent au milieu du XVIIIe siècle dans une focalisation sur le menuet et les contredanses. La plupart des sources allemandes, notamment les écrits de Behr (1703, 1709 et 1713), Bonnefond (1705), Bonin (1712), Taubert (1717), sont antérieures à 1725, mais plusieurs publications aux Pays-Bas (Sol, 1725), en Angleterre (Tomlinson, 1735), en Italie (Dufort (1728) ou en Espagne (Ferriol, 1745) offrent après Rameau de nouveaux modèles d’explicitation ou d’illustration des pas voire des bras. Plusieurs pistes pourront être explorées : les influences du Maître à danser sur l’écriture d’autres traités de danse ; plus généralement les différentes formes que prennent les traités européens, leurs particularismes, leurs motivations, leurs contextes, leurs publics, etc. Comment interpréter ces spécificités : en quoi ces traités constituent-ils un apport singulier à l’élaboration d’un style, national ou non ? Quelles filiations et parentés peut-on discerner entre différents enseignements ? Des comparaisons sur des points techniques pourront s’avérer cruciales pour repérer les constantes, les variantes, les écarts, les systèmes, les adaptations, en questionnant la manière dont les circulations, les influences, les transferts et les appropriations ont transformé la danse d’origine française en un style européen plus ou moins homogène. Le choix des répertoires musicaux et chorégraphiques utilisés comme exemples pédagogiques, autant que leur circulation, pourront aussi donner lieu à des comparaisons.
Un quatrième axe reprendra l’histoire de la réception des ouvrages de Pierre Rameau, pour évaluer comment la publication de ces livres a pu faire date dans l’histoire plus générale de la danse, sa transmission, son inscription sociale et ses institutions. Le Maître à Danser est plusieurs fois réédité et présent dans de nombreuses bibliothèques, et certains de ses énoncés sont parfois repris textuellement dans des publications ultérieures, notamment l’Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt (1751-1772) ou encore le Dictionnaire de la danse de Compan (1787). Cette dissémination donne lieu à des simplifications, des adaptations, de nouvelles combinaisons. On pourra ici mener une recherche plus exhaustive de ces citations dans d’autres sources, et en déterminer les contextes, les stratégies, en s’attachant à observer comment une conservation des descriptions techniques correspond ou non à la permanence ou l’évolution des pratiques à la même époque. La réception de l’Abbrégé permettra d’aborder la polémique déclenchée par le maître à danser Hardouin au sujet des changements apportés à la notation fixée par Feuillet en 1700, afin de cerner les enjeux de cette querelle, autant que l’implication et le rôle de l’Académie royale de Danse. Cette polémique contribue à éclairer aussi la position de Rameau vis-à-vis de son lectorat comme de ses collègues. Enfin, sa réédition très tardive des “danses de ville”, dans son nouveau système de notation, invite à s’interroger sur la permanence de ce répertoire spécifique, au-delà des publications annuelles auquel il est lié. De fait, la publication de notations de ces danses de bal figurées s’interrompt également en 1725.
Un cinquième et dernier axe du colloque portera sur les appropriations actuelles du Maître à danser, depuis ses premiers (re)lecteurs du XXe siècle jusqu’aux analyses des chorégraphes et danseurs engagés à ce jour dans les pratiques de restitution de la danse ancienne de bal et de théâtre. Comment définir et élaborer notre lecture des textes techniques anciens ? Comment appuyer la remise en acte sur une contextualisation des formulations, sur une histoire du vocabulaire, sur un repérage des implicites ? Dans quelle mesure la réinterprétation en acte des traités doit-elle être accompagnée de réécritures, d’adaptations des énoncés pour la transmission, d’expérimentations de solutions variées, nouvelles, d’allers-retours entre texte et action ? Comment la lecture de Pierre Rameau concourt-elle à une manière de remettre en mouvement, à une technique actuelle, et à un sens restitué des pratiques ?
Un colloque de deux jours (11-12 décembre 2025) sera accueilli à la Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, centré sur les communications scientifiques
Une demi-journée sera également consacrée à une table ronde sur la danse baroque aujourd’hui, et à des présentations dansées du répertoire noté ou mentionné par Pierre Rameau – notamment en collaboration avec la Fédération française des professionnels en danse ancienne (Association Pro DA).
The year 2025 will mark the 300th anniversary of the publication of a major work for the understanding of the dance of the 18th century: Le maître à danser. Qui enseigne la manière de faire tous les différens pas de danse dans toute la régularité de l’art, & de conduire les bras à chaque pas [English: The Dancing-Master which Teaches the Manner of Performing all the Different Steps in Dancing in All Regularity of the Art and How to Move the Arms with Each Step] by Pierre Rameau (1674-1748). Around the same time, he also published his Abbregé de la nouvelle methode, dans l’art d’ecrire ou de traçer toutes sortes de danses de ville [Summary of the New Method in the Art of Writing or Tracing All Sorts of Ball Dances]. Le Maître à danser was disseminated widely, was republished multiple times until 1748 and translated into English by John Essex in 1728 and adapted into Spanish by Ferriol. It exerted strong influence on many subsequent publications, in France as well as elsewhere, whether in treatises on French dance technique or in articles on dance in encyclopaedias or dictionaries. Today it is considered one of the central sources for the reconstruction of Baroque Dance.
On the anniversary of this publication, we wish to review the history and the content of the Maître à danser, but also the circumstances of its creation, situating it more generally in the history of treatises on dance technique during the first half of the 18th century. The conference will also cover practices of which the treatise merely bears traces of, which have only been revealed in recent research. The objective of this colloquium will thus be twofold: To gain a fuller picture of the role of this work in the 18th century and its effects on current practices in the reconstruction of Early Dance.
The first axis of the colloquium covers the historical and social context of Maître à danser: The main stages of the life and career of Pierre Rameau, active in Lyon, Strasbourg and Paris, as well as prosopographical aspects have already been scrutinized, yet we still require a better understanding of his practice as a dancing master, his students and the contexts of his own education. The study of conserved copies of his works in the main libraries, but also the analysis of the didactical approach employed by Rameau in his treatises, permits us to renew and deepen different forms of enquiry: Who were the readers and especially the users of Pierre Rameau’s works? In which pedagogical contexts were they used? What can the texts and images of Rameau’s treatises convey about the practices of dancers and distinguished persons of the 18th century? The learning of good manners and civility, which occupies many chapters of the work, merit a deeper enquiry and comparison with other sources, aimed at a better understanding of its modalities of application.
A second axis of the conference is interested in the exposition of technique by Pierre Rameau. While the moral, apologetic, generic or aesthetic dimensions of dance treatises have been the subject of many studies, this is less the case for the subject which is at the heart of their specificity: They are texts orientated towards the description or the prescription of danced movement. Regarding this elusive object, it is the complex and instantaneous combination of heterogeneous elements (space, time, energy, body weight…) which one must seize. By which processes and by which means are movement, its continuation, and its synthesis, each of which operates in its own parameters, consigned, organised, regulated, abbreviated or – conversely – overly determined? Of what does the production of choreographic technical text consist, a setting into words of actions but also of intentions and qualities? Of what does it bear witness – of a global, systematic approach to dance and its transmission? In what bandwidth of possible choices of method, of a “manner of teaching”, does it reveal an analysis or an understanding of how to view a form of thinking about movement? What links can one establish with contemporaneous dance notation systems? What musical understandings are manifested by these teachings, and what are their rapports with contemporaneous forms of musical practice, theory, and repertoire? What criteria precede the choice of musical and choreographic examples? How do the treatises bear witness to historical perceptions of the particularities of the body, space and time, as well as anatomical, physical and physiological, geometric, and more general currents of thinking of the early 18th century? Another essential point for the understanding of this source type is what the underlying and unspoken matters of a technical treatise consist of: What aspects can it tacitly pass by as everyone in the period is aware of them? How do we uncover these implicit matters, these pieces of evidence of forgotten practices? More generally, what conceptions of dance are conveyed by the technical texts, especially relating to its function, to those who dance or to a culture of the body which supports a strongly developed form of self-representation? In what ways is a treatise of technique a bearer of norms as well as of innovations, and how – within the defined scope – can it propose processes of composition and the latitude of interpretation?
A third axis replaces the close examination of Rameau with that of a much larger group of newly produced works dedicated to dance practice throughout Europe – to writings dealing with forms of notation, but even more to treatises focused on the execution of ballroom dances and specifically the “danses de ville”, before the dance books shift to an almost exclusive coverage on the minuet and the country dances in the mid-18th century. Most of the German sources, particularly the writings of Behr (1703,1709 and 1713), Bonnefond (1705), Bonin (1712), and Taubert (1717), appeared before the publication of Rameau’s works in 1725, but afterwards multiple works in the Low Countries (Sol, 1725), in England (Tomlinson, 1735), in Italy (Dufort, 1728) or in Spain (Ferriol, 1745) offer new models of explanation or illustrations of the steps and even of arm movements. Many approaches can be investigated: The influences of Maître à danser on the writing of other dance treatises, or, more generally, the different forms that European treatises took, their particularities, motivations, contexts, their audience, etc. How do we interpret these specificities – do these works constitute the elaboration of an individual style, be it national or not? What degrees of filiation or parentage can one discern between different treatments? The comparisons on technical details can prove crucial to establishing the constants, variants, deviations, systems, and adaptations, while questioning the way these circulations, influences, transfers, and appropriations transform a form of dance of French origin towards a more or less uniform European style. The choice of musical and choreographic repertoire used as pedagogical examples, as well as their circulation, can also provide an important space for comparison.
A fourth axis looks towards the reception of the works of Pierre Rameau, in order to evaluate how the publication of these books impacted the more general history of dance, its transmission, its social impact and its institutions. Le Maître à Danser was re-issued many times and is present in a large number of libraries, and certain of its formulations were taken up textually in later publications, notably the Encyclopédie edited by Diderot, d’Alembert and Jaucourt (1751-1772) or also the Dictionnaire de la danse of Compan (1787). This dissemination gave space to simplifications, adaptations, and new combinations. Here one may undertake a more than exhaustive search of citations in other sources, and in determining the contexts and strategies one may observe how the conservation of technical descriptions neither fully corresponds to a permanence nor to a rapid evolution of practices in the same period. The reception of Abbrégé allows us to approach the fierce polemic by dancing master Hardouin about changes to the form of notation set down by Feuillet in 1700; in observing the course of this conflict, one may reach new conclusions regarding the implied role of the Académie royale de Danse. This polemic contributes to a clarification of the position of Rameau vis-á-vis his readership as well as his colleagues. Finally, his late re-edition of the “danses de ville” in his new system of notation invites us to question the permanence of this specific repertoire and the later echo of the annual publications to which it is linked: The annual publication of the notations of these figured ballroom dances is interrupted the same year as Rameau published his works, namely in 1725.
A fifth and final axis of the colloquium concerns the current applications of the Maître à danser, from its first (re-) readers of the 20th century up to current analyses by choreographers and dancers engaged in the practice of reconstituting ancient ballroom and stage dances. How should we define and elaborate on our reading of ancient technical texts? How does one support re-enactment by a contextualisation of formulations, by a history of vocabulary, and by a tracing of implicit notions? Must this appraisal of the reinterpretation into action of treatises be accompanied by re-readings, adaptations of statements for interpretation, experimentations with varied and novel solutions, and a constant back and forth between text and action? How does the reading of Pierre Rameau contribute to a manner of re-enacting by way of movement, in a current technique, and in a sense of reconstituted practices?
A conference of two days (11-12 December 2025), at the Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret, centered on scientific papers.
A half-day with a round table on baroque dance today, with danced presentations of the repertoire notated or mentioned by Pierre Rameau – notably together with Early Dance professionals (Federation ProDA).
Comité scientifique – Scientific Board
Marie Demeilliez (Université Grenoble Alpes – IUF), Marie Glon (Université de Lille), Hubert Hazebroucq (Cie Les Corps éloquents- Schola Cantorum de Bâle), Jean-Noël Laurenti (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance), Raphaëlle Legrand (Sorbonne Université), Marie-Thérèse Mourey (Sorbonne Université), Laura Naudeix (Université Rennes 2)
Les propositions de communication comprendront un maximum de 500 mots. Celles-ci devront joindre le titre de la communication, et une brève notice bio-bibliographique précisant l’institution d’attache. Merci de préciser si la présentation aura besoin d’un espace pratique.
Les propositions devront être envoyées avant le 30 avril 2025 aux adresses suivantes :
marie.demeilliez@univ-grenoble-alpes.fr
Une réponse sera donnée aux participant·e·s sélectionné·e·s à la fin du mois de juin.
Les organisateurs prévoient la prise en charge des repas, et pourront éventuellement étudier la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement, au cas par cas.
The abstracts of proposed papers should not exceed 500 words. They should comprise the title of the paper and a short bio-bibliographical note mentioning institutional attachments. Please state whether the presentation will contain practical elements.
Applications must be submitted before 30 April 2025 to the following addresses:
marie.demeilliez@univ-grenoble-alpes.fr
Selected participants will be informed by the end of June.
The organisers will provide meals and may consider covering travel and accommodation costs on a case-by-case basis.
Comité d’organisation – Organising Committee
Marie Demeilliez (Université Grenoble Alpes – IUF), Irène Feste (Cie Danses au Passé), Irène Ginger (Acras et Association Pro DA), Hubert Hazebroucq (Cie Les Corps éloquents- Schola Cantorum de Bâle), Laura Naudeix (Université Rennes 2), Thomas Vernet (Fondation Royaumont – Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret)
Partenaires – Partners
ACRAS (Association pour un Centre de Recherche sur les Arts du spectacle aux XVIIe et XVIIIe siècles)
APP (Arts, Pratiques et Poétiques) – Université Rennes 2
Association Pro DA (Fédération française des professionnels en Danse Ancienne)
Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret – Fondation Royaumont
Dance & History Verein
Institut Universitaire de France
LUHCIE (Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe) – Université Grenoble Alpes