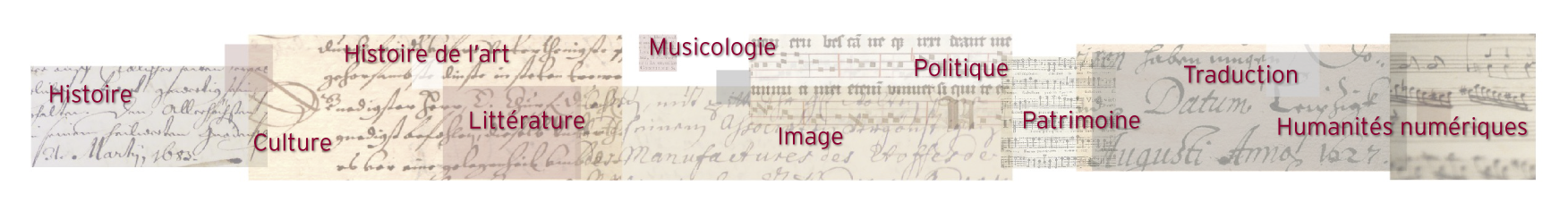Programmes de recherche
PROGRAMMES DE RECHERCHE EN COURS AU LUHCIE
AXE 1 : Circulations, transferts, frontières
DICEX (Diplomatie Italo-Chilienne et Exil. Une histoire politique et solidaire)
Pilotage : Elisa Santalena, Maîtresse de Conférences HDR, Université Grenoble Alpes, laboratoire LUHCIE.
(Initiatives de Recherche à Grenoble Alpes – IRGA)
L’impact que le 11 septembre chilien ne cesse d’avoir sur l’opinion publique mondiale a donné lieu à de nombreuses études de cas, auxquelles s’ajoute une historiographie de plus en plus vaste. Le projet DICEX (Diplomatie Italo-Chilienne et Exil. Une histoire politique et solidaire) vise à contribuer au développement de la recherche sur l’exil chilien en tant que phénomène politique et solidaire transnational.
À partir de l’analyse de documents politiques et diplomatiques sur l’exil chilien en Italie à la suite du coup d’État civico-militaire de 1973, nous étudierons les traces laissées par celles et ceux qui se sont engagé.e.s dans des activités de solidarité, qu’il s’agisse du personnel diplomatique italien à Santiago ou de celui des différents ministères à Rome, tout comme de l’engagement du monde institutionnel. Plusieurs terrains de recherche seront menés dans les archives des ministères des Affaires Étrangères et de l’Intérieur des deux pays dans le but d’approfondir l’histoire de l’accueil et l’insertion dans la Péninsule des centaines d’hommes, femmes et enfants fuyant la répression sanglante de la Junte militaire d’Augusto Pinochet et de celles et ceux qui ont contribué à sa mise en œuvre.
Pour ce faire, une équipe pluridisciplinaire franco-italo-chilienne sera mobilisée, composée de spécialistes d’histoire et civilisation des deux pays ainsi que de l’aide précieuse de plusieurs archivistes.
Le projet DICEX s’inscrit dans la thématique des transferts culturels et politiques, des migrations et de l’exil de l’axe 1 du laboratoire LUHCIE intitulé « Circulations, transferts, frontières ».
Collaborations : Franck Gaudichaud (Professeur en histoire et études latino-américaines contemporaines à l’Université Toulouse Jean Jaurès et membre du laboratoire FRAMESPA) ; Monica Galfrè (Maîtresse de Conférences HDR en histoire et civilisation de l’Italie contemporaine à l’Université de Florence, Italie).
Manifestations prévues dans l’immédiat: colloque international Nel cuore degli anni ’70 italiani. La svolta del 1973-1974. (Università degli Studi di Firenze, 5-7 juin 2024). Ce colloque marquera officiellement la mise en place de la collaboration et le début du projet.
Réalisations
Elisa Santalena, Italie et Chili au cœur de la guerre froide. Enjeux géopolitiques et dynamiques de solidarité (1957-1976), Grenoble, UGA Éditions, 2026
Deux publications à la fin du projet.Coordination du volume issu du colloque Nel cuore degli anni ’70 italiani. La svolta del 1973-1974 avec Mme Monica Galfrè et d’un ouvrage avec M. Franck Gaudichaud.
SOLIDAMIN (Solidarités communautaires. Réseaux d’entraide des minorités et des diasporas dans l’Europe des 17e-18e siècles)
Pilotage : Mathilde Monge (Université de Toulouse Jean Jaurès)
Co-responsable scientifique du séminaire SOLIDAMIN et du colloque final (juin 2026) : Naïma Ghermani
ANR-21-CE41-0022
Présentation du projet :
L’équipe du programme ANR SOLIDAMIN interroge la solidarité et les pratiques d’entraide développées par les diasporas des minorités religieuses, dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce programme rassemble des chercheurs et des chercheuses d’universités françaises (Toulouse Jean-Jaurès, Université de Lorraine, EPHE, EHESS, Université de Lyon III, Aix-Marseille, Grenoble) et d’universités européennes (Leiden University, Real Academia de la Historia, Universidad Pablo de Olavide-Séville, Queen Mary University Londres). Adoptant une perspective comparatiste, il met en regard des formes solidarité intra-et inter-communautaires, en se penchant tout particulièrement sur les nombreuses collectes organisées en Europe notamment au profit des victimes des grandes vagues de politiques coercitives, mais aussi pour l’entretien matériel et la survie des groupes minoritaires.
SAVONARONLINE
Porteur du projet : Cécile Terreaux-Scotto
Résumé court du projet de recherche
Le projet émergent et exploratoire SAVONARONLINE vise à mettre en ligne une dizaine de sermons (300 pages) du prédicateur Savonarole (1452-1494) dans lesquels la question de la prophétie est centrale. Assortie de notes historiques, théologiques, philosophiques et culturelles, d’un commentaire rhétorique et de passages traduits en français, cette anthologie sera valorisée sur un site internet. Les outils numériques mobilisés seront pionniers pour la mise en ligne d’un ensemble de 252 sermons du dominicain (environ 6300 pages) et d’un corpus de textes abordant la prophétie (1000 pages environ) dans le cadre du programme pluridisciplinaire et international PROPHIST initié en octobre 2024.
Date à laquelle le projet de recherche a commencé
27 octobre 2024 : colloque international et pluridisciplinaire sur Catherine de Sienne (avec une réflexion sur la forme de communication spécifique à la parole prophétique) organisé à l’UGA par Sonia Porzi, Université de Clermont-Auvergne, IHRIM/CNRS et Cécile Terreaux-Scotto, LUHCIE.
Résumé scientifique du projet
Dans La chute, Camus qualifie les « moralistes » de « savonarole ». Mais ce nom commun est d’abord celui d’un dominicain (1452-1498) qui s’est opposé au pape Alexandre VI Borgia et aux Médicis. Pour ne pas laisser le prédicateur enfermé dans sa « légende noire » d’hérétique pendu puis brûlé, Fournel et Zancarini ont publié en 2024 une nouvelle biographie. Ils montrent comment l’enregistrement, la diffusion et la conservation de la parole de Savonarole est devenu un enjeu à la fois politique et spirituel dès lors qu’il a proposé une réforme des institutions florentines après le départ forcé de Pierre de Médicis. Mais s’ils qualifient cette parole « d’arme », ils n’analysent pas la rhétorique des sermons.
Revendiquant une prophétie performative, Savonarole proclamait pourtant que « [s]on dire est un faire ». Au cœur du programme de recherche international PROPHIST – prophétie et histoire – dont le premier jalon a été posé le 27 octobre 2024 avec un colloque sur Catherine de Sienne, il apparaît fondamental de mener une enquête approfondie sur la parole savonarolienne.
Le projet émergent et exploratoire SAVONARONLINE vise à mettre en ligne une édition augmentée des sermons de Savonarole. Une anthologie d’une dizaine de sermons choisis pour ce qu’ils disent de la façon dont il envisage la prophétie sera constituée. Établie à partir de l’édition nationale (Rome, Angelo Belardetti, 1955-1974) désormais libre de droits, elle sera enrichie de mots cliquables et de renvois vers des notes inédites de contextualisation historique, théologique, philosophique et culturelle. Des appels de notes baliseront le commentaire rhétorique tandis qu’un onglet sera réservé à la traduction en français de passages significatifs. Par la suite et selon ces mêmes modalités seront publiés sur le site l’ensemble des sermons (6300 pages environ) ainsi qu’un corpus de textes abordant la prophétie (1000 pages environ).
Place et intérêt du projet au regard de l’existant
Non seulement les biographies de Savonarole sont très nombreuses, mais il est aussi assez bien connu du grand public, par exemple comme religieux fanatique dans le jeu vidéo historique Assassin’s Creed ou bien comme fauteur de troubles et instigateur des bûchers des vanités dans la série télévisée italo-britannique Les Médicis, maître de Florence.
Par ailleurs, dans un article publié en 2022 sur le blog Actuel Moyen Âge sous le titre « Mélenchon, un prédicateur de la Renaissance ? », on peut lire que « ces figures de réformateurs ont fait de leur puissance oratoire un instrument majeur de leur combat politique, en se présentant en prophètes, porteurs d’une transformation générale de la société, à la fois institutionnelle et morale, en des temps troublés » (Simon Hasdenteufel).
Pourtant, l’étude de la « puissance oratoire » de Savonarole n’a jamais été conduite de façon exhaustive. De ce point de vue, le volume publié en 2023 chez Droz, L’édifice des sermons savonaroliens. Politique et rhétorique à Florence à la fin du XVe siècle (C. Terreaux-Scotto), fait figure d’exception.
Dans nos sociétés anxiogènes où les prédictions prennent volontiers la place de l’analyse rationnelle, où les liens entre religion et politique se posent avec toujours plus d’acuité et où la parole politique se multiplie sur les réseaux sociaux, une mise à disposition des sermons annotés et analysés d’un point de vue rhétorique permettrait de mieux comprendre comment la parole peut assurer la gloire ou provoquer la déchéance.
En outre, ce travail éditorial posera les fondements du programme de recherche pluridisciplinaire et international qui vise à analyser sur un temps long (XIIe-XVIe siècles) et en Europe comment s’articulent Prophétie et Histoire (prédictions et visions, temps de Dieu et temps de l’histoire, liens avec l’Église et le pouvoir politique, pour ne citer que quelques axes de réflexion).
Personnes impliquées
Cécile Terreaux-Scotto, Université Grenoble Alpes, LUHCIE, encadrement des travaux, choix du corpus, traduction, commentaire rhétorique, 100%
Laurent Baggioni, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CERLIM, liens avec l’humanisme, traduction et prophétie politique 75%
Michele Lodone, Università di Modena e Reggio-Emilia (Italie), notes historiques et enjeux prophétiques 50%
Bernard Hodel, Université de Fribourg (Suisse), notes théologiques et philosophiques, tradition thomiste 50%
Sonia Porzi, Université Clermont-Auvergne, IHRIM / CNRS, héritage de Catherine de Sienne et tradition dominicaine 50%
Références bibliographiques
Sonia Porzi, Céline Pérol (dir.), Catherine qui fut de Sienne. Écrits et culte de sainte Catherine en Italie et en France (XIVe-XXIe siècle), Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2025. ISBN 9782383772972
Cécile Terreaux-Scotto, L’édifice des sermons savonaroliens. Politique et rhétorique à Florence à la fin du XVe siècle, Genève, Droz, 2023. ISBN 978–2–600–06410–1
Michele Lodone, I segni della fine. Storia di un predicatore nell’Italia del Rinascimento, Rome, Viella, 2021. ISBN 9788833138145
ARCHIBEAU (Archives numériques de la correspondance et des papiers manuscrits de Beaumarchais)
Pilotage : Linda Gil (Université Montpellier Paul Valéry, IRCL), Coordinatrice scientifique
(ANR AAPG2024)
Responsables scientifiques
Gilles Montègre (UGA, LUHCIE), Virginie Yvernault (Sorbonne-Université, CELLF), Stéphane Pujol (Université Toulouse Jean Jaurès, PLH)
Présentation du projet :
Le projet Archibeau a pour objectif de rassembler et d’étudier l’archive encore largement inédite des papiers manuscrits de Beaumarchais, en vue de réaliser un inventaire analytique et une édition numérique de l’ensemble des données disponibles. Cette édition numérique sera le préalable à une édition critique intégrale, en volumes imprimés, de la correspondance et des papiers (notes, mémoires, études et projets divers) de Beaumarchais. En effet, en dépit de publications éparses et fragmentaires, il n’existe toujours pas d’édition intégrale de la correspondance et des papiers de Beaumarchais : le projet Archibeau entend lever ce verrou scientifique majeur. Le programme de recherche coïncide avec l’entrée à la BnF de plus de 25 000 documents inédits provenant de la récente donation de Jean-Pierre de Beaumarchais. Le projet vise donc au premier chef à rendre cette archive accessible aux spécialistes et aux non spécialistes, et à la confronter avec d’autres fonds publics français et internationaux. Cette entreprise permettra d’approfondir la connaissance d’un « entrepreneur des Lumières » dont les activités se situent à la croisée de la littérature, de la diplomatie et de la finance. Par l’étendue et par la variété de son réseau, Beaumarchais défie en effet les approches scientifiques traditionnelles. Le projet Archibeau vise par conséquent à ressaisir les liens entre littérature, finance et politique dans le monde globalisé du 18e siècle.
L’inventaire numérique des papiers Beaumarchais sera un outil destiné aux chercheurs et à un public plus large, en open edition, conformément à la politique d’Humanum, plateforme qui héberge notre base de données et pour laquelle va être recruté un ingénieur de recherche (au début de l’année 2025). Par-delà la constitution et la mise à jour de la base, le projet est articulé autour de cinq hypothèses de recherches.
- Lumières et nomadisme social
Beaumarchais se présente comme un cas de figure décisif pour mieux comprendre ces milieux sociaux de l’entre-deux, qui ont joué un rôle si important dans l’épanouissement des Lumières au cours de la seconde moitié du 18e siècle. Dans sa correspondance, c’est avec la même aisance et parfois avec le même ton cavalier qu’il s’adresse à l’épouse d’un ouvrier de son atelier d’imprimerie et au ministre des Affaires étrangères Vergennes, à un courtier en assurance et à l’archiduchesse Marie-Thérèse. Seule une étude attentive menée sur la base de l’intégralité des manuscrits de Beaumarchais permettra de comprendre les contraintes et les potentialités qui s’offraient à ces transfuges de classe du 18e siècle.
- Les pouvoirs de l’écriture
Tout en épousant une tradition qui, dans le sillage de la révolution épistolaire, promeut un usage politique et performatif de la lettre, Beaumarchais fut de ceux qui inventèrent au 18e siècle des méthodes de communication modernes afin de médiatiser ses affaires et d’utiliser l’opinion publique pour peser sur les institutions et mener ses combats. La confrontation de sa correspondance privée, des échanges épistolaires ostensibles et des courriers ouverts publiés dans la presse permettra de mieux comprendre comment se renouvelle au 18e siècle l’usage médiatique de la lettre.
- Œuvre littéraire et politique des Lumières
L’étude de l’archive Beaumarchais saisie dans sa totalité permettra d’éclairer de manière nouvelle l’œuvre littéraire (théâtrale, judiciaire et polémique), tout en exhumant des écrits plus proprement politiques et jusqu’à présent inédits. Cette approche globale offre l’image nouvelle d’un Beaumarchais philosophe, dont la pensée politique aboutit à une vision originale de la philosophie des Lumières, associant diffusion du livre et conquête des droits de l’homme.
- L’arène judiciaire du réformisme
Inventeur de formes dramatiques nouvelles, entrepreneur de spectacles, Beaumarchais est aussi un militant des droits des auteurs dramatiques, et un pamphlétaire redoutable contribuant à diffuser une pensée réformatrice dans le domaine de la justice. L’examen croisé de ses papiers permettra de rendre compte au fil de l’archive d’une action réformiste située à la croisée du mécénat traditionnel, de l’activisme judiciaire et de l’entreprenariat culturel moderne.
- Pratiques protéiformes de la diplomatie
Artisan de l’ombre de la French Alliance qui fut un moteur de la Guerre d’Indépendance américaine, espion employé au service des Bourbons de Versailles et de leurs alliés de Madrid, Beaumarchais incarne ces pratiques protéiformes qui singularisent la diplomatie européenne dans le dernier quart de l’Ancien Régime. Ses archives s’offrent comme une ressource fondamentale pour en étudier les limites autant que les ressorts sous-jacents, parmi lesquels se singularisent de multiples formes de diplomatie culturelle.
Equipe :
Dimitri Albanese (IHRM Saint-Etienne), Gauthier Ambrus (Sorbonne Université, CELLF), Flavio Borda d’Agua (Institut-Musée Voltaire, Genève), Marc Buffat (Université Paris-Diderot), Frédéric Calas (Université de Montpellier, IRCL), Fabrice Chassot (Université de Toulouse, PLH), Simon Davies (Université de Belfast), Valentine Dussueil (Sorbonne Université, CELLF), Béatrice ferrier (INSPE-Lille), Gérald Folliot (CNRS, TGIR Humanum), Eric Francalanza (UBO, Brest), Linda Gil (Université de Montpellier, IRCL), Martin Giraudeau (Science Po Paris), John Iverson (Whitman College, Washington), Françoise Launay (CNRS, Observatoire de Paris), Rudy Le Mentheour (Bryn Mawr College, Pennsylvanie), Gilles Montègre (UGA, LUHCIE), Laura Naudeix (Université Rennes 2), Bénédict Obitz-Lumbroso (Université du Maine), Stéphane Pujol (Université de Toulouse, PLH), Nicolas Rieucau (Université Paris 8), Jennifer Ruimi (Université de Montpellier, IRCL), Franck Salaün (Université de Montpellier, IRCL), Otto Selles (Calvin University, Michigan), Patrick Taïeb (Université de Montpellier, IRCL), Virginie Yvernault (Sorbonne Université, CELLF).
Manifestations scientifiques :
Colloque international “Beaumarchais and the Americas : business, political and cultural networks, an archive to be explored”, New York (Columbia University, Fordham University), 25-26 octobre 2024
Journée d’étude : Beaumarchais et la culture aristocratique. Réseaux et pratiques épistolaires, Saint-Germain-en-Laye, Hôtel de Noailles, 11 rue d’Alsace, Du 04-05/06/2025
Osiris. Rassembler l’épars
Pilotage : Djamila Fellague, Université Grenoble Alpes, Luhcie.
Responsable de l’imagerie 3D : Benjamin Houal (imagerie et modèle 3D)
Résumé
Le projet a trois objectifs liés.
– Retrouver des provenances d’objets archéologiques romains, dans les musées et sur le marché de l’art. La prise en compte du lieu et du contexte de découverte permet alors une meilleure interprétation de l’objet et lui offre une nouvelle identité.
Nous ne nous intéressons pas qu’aux pièces frauduleuses, mais, dans bien des cas, retrouver la provenance de l’objet conduit à démontrer que l’objet a été volé ou qu’il a été très vraisemblablement pillé. Nous nous intéressons également aux pièces archéologiques fausses (qui sont innombrables sur le marché de l’art).
– Localiser des objets considérés comme « perdus » (objets entrés anciennement dans des collections d’un musée ou signalés anciennement dans des collections particulières) ou même déjà les identifier pour pouvoir les chercher et les retrouver.
– Reconstituer un objet démembré à partir de fragments. Ces derniers peuvent être conservés en un même lieu ou éparpillés dans le monde.
L’échelle d’investigation est vaste pour les pièces du marché de l’art (exemples de découvertes concernant des pièces frauduleuses provenant de / originellement conservées en : Afghanistan, Algérie, Argentine, Autriche, Bulgarie, Espagne, France, Italie, Liban, Syrie, Turquie).
À l’échelle nationale, nous nous concentrons pour l’instant sur le mobilier archéologique de Lyon et de Vienne, en particulier le mobilier lapidaire.
Collaborations
Collaborations avec des chercheurs et échanges avec les autorités de divers pays en fonction des découvertes et des thématiques abordées lors des journées d’études.
Collaborations institutionnelles avec des musées : Musées de Vienne, commune de Vienne (dir. Isabelle Dahy ; en charge des collections : Virginie Durand) ; Musée d’Histoire de Vienne en construction (dir. Julie Chevaillier).
Manifestations scientifiques
– Journée d’étude, 12 février 2025 : 1ère journée d’étude. Le chercheur face aux pillages et aux faux.
– D. Fellague, « Vols, faux et marché de l’art », conférence le 3 juin 2025 à l’invitation de la MSH Alpes.
Échange avec le public suite à la projection d’un documentaire
Djamila Fellague, Sabine Fourrier, Alexandre Rabot, échange avec le public sur la circulation des biens culturels lors des Journées européennes du Patrimoine après la projection du documentaire l’Apollon de Gaza, samedi 14 juin 2025 au cinéma le Comoedia à Lyon. Événement organisé par le village de l’Archéologie.
Restitutions d’objets volés identifiés
Restitution de l’Italie à l’Espagne d’un autel funéraire romain volé dans une réserve archéologique à Mérida en 1996 ; cérémonie à l’ambassade espagnole à Rome le 10 février 2025.
Restitution de l’Espagne à la Bulgarie d’une stèle romaine du « Cavalier Thrace » volée dans un musée en Bulgarie en 1996 ; cérémonie à l’ambassade de Bulgarie à Madrid le 18 juin 2025.
Publications
– Projet de publication d’un ouvrage collectif.
– Sept articles parus de février 2024 à septembre 2025 sur des pièces archéologiques frauduleuses ; un article sous presse.
– D. Fellague, « Pèlerinage à Rome, fouilles clandestines sur la via Appia et omission du chercheur », article sous presse pour des Mélanges.
– D. Fellague, « De la Bulgarie à l’Espagne en passant par la France. Le voyage du ‘Cavalier thrace’ et de l’antiquaire épris d’Alexandre », Le blog du CPRProvenances, 12 septembre 2025.
https://cprprovenances.eu/index.php/2025/09/12/de-la-bulgarie-a-lespagne-en-passant-par-la-france-le-voyage-du-cavalier-thrace-et-de-lantiquaire-epris-dalexandre/
– D. Fellague, « Identification d’un autel romain volé à Mérida (Espagne) », Le blog du CPRProvenances, 27 avril 2025.
– D. Fellague, « Pièces archéologiques du palais royal de Ghazni (Afghanistan) aux enchères. A propos de deux ventes récentes, en Angleterre et aux États-Unis », Le blog du CPRProvenances, 4 février 2025.
– D. Fellague, « Algérie. Des sculptures romaines volées retrouvent leur identité », Archéologia, 635, octobre 2024, p. 18-19.
– D. Fellague, « Des mosaïques pillées puis vendues en France ? », Archéologia, 631, mai 2024, p. 12-13.
– D. Fellague, « Expertise scientifique et trafic d’antiquités : des copies remises au Liban ? », Archéologia, 629, mars 2024, p. 48-55.
– D. Fellague, « Deux sculptures volées au Liban récemment identifiées », Archéologia, 628, février 2024, p. 21.
Patrimalp tools : Pigments, Matières, Lumières : les couleurs du patrimoine
(Cross Disciplinary Program tools- ANR-15-IDEX-02)
Pilotage : Laurence Rivière Ciavaldini, Université Grenoble Alpes, LUHCIE, Pauline Martinetto, CNRS, Institut NEEL, Emilie Chalmin, EDYTEM, Université Savoie-Mont-Blanc, Véronique Adam (Litt&Arts)
Nom de l’équipe ou des équipes impliquées :
Luhcie, Litt&Arts, Institut Néel, LJK, LIG, IPAG, OSUG, Arc-Nucléart, ESRF
Résumé
Patrimalp (Cross Disciplinary Program_2017-2021 puis 2022-2025) engagé dans la recherche interdisciplinaire sur le patrimoine matériel et immatériel se poursuivra au cours des années 2026-2030, avec un soutien de l’UGA de 150K€.
L’objectif scientifique de Patrimalp est de développer une science interdisciplinaire du patrimoine et de modéliser une méthodologie centrée sur « l’objet-frontière », concept porteur d’un double enjeu : disciplinaire, il interroge chaque discipline dans son propre
champ ; interdisciplinaire : il mobilise chaque discipline dans ses relations aux autres et vise à développer un ensemble structuré de la connaissance.
Patrimalp implique 7 laboratoires rhône-alpins (EDYTEM, IPAG, LJK, LUHCIE, Litt & Arts, Institut NEEL) et 13 partenaires dont (ESRF, ARC-Nucléart / CEA, OSUG, Fondation des Sciences du Patrimoine, 6 musées, 2 bibliothèques).
Biblia sacra cartusiana
Les recherches qui concernent directement les membres du LUHCIE portent sur les conditions de production matérielles et intellectuelles de grandes Bibles enluminées réalisées au monastère de la Grande Chartreuse au cours du XIIe siècle (conservées à la
Bibliothèque de Grenoble). A l’aide de Mobidiff, un instrument portable mis au point dans Patrimalp (CDP 1) des mesures non invasives et non destructives de diffraction et de fluorescence des rayons x sont effectuées sur les encres et les pigments des
manuscrits, au chevet de l’œuvre.
Ces mesures permettent d’identifier des savoir et des savoir-faire, lesquels, croisés à l’étude des sources techniques (recettes, réceptaires, traités techniques médiévaux) et au contexte historique qui entoure la vie des Chartreux, rendent compte de cette activité
majeure de copie des textes saints, définie dans le Propositum cartusien, à l’intérieur du monastère et dans ses relations avec le monde extérieur.
Sculptures polychromes
Une deuxième enquête s’attache à l’étude des polychromies en léger relief, connues sous le nom de « brocarts appliqués », identifiées sur un corpus de 17 sculptures produites dans l’ancien duché de Savoie à la toute fin du Moyen Âge (1480-1530). Cette recherche vise à établir un catalogue formel des motifs, à l’aide de Mobidiff (voir ci-dessus), à définir leurs modes de fabrication à des fins de conservation et de restauration, et in fine, à mieux comprendre le rôle de l’espace alpin dans la circulation de ces procédés techniques de pointe, entre le Nord et le Sud de l’Europe, autour de 1500. L’ensemble de ces données sera, à terme, intégré dans une ontologie ou graphe de connaissances en open data, mis à disposition de la communauté scientifique et du grand publi
Partenariats
Informations supplémentaires sur l’actualité de Patrimalp : https://patrimalp.univ-grenoble-alpes.fr
Repenser l’histoire du clavecin français (XVIIe-XVIIIe siècles)
Pilotage : Marie Demeilliez
Résumé
Ce projet de recherche se propose de renouveler l’histoire du clavecin français aux XVIIe et XVIIIe siècles en étudiant des corpus musicaux peu connus et en articulant l’histoire des pratiques musicales à l’histoire culturelle et à l’histoire du corps. Le clavecin a la particularité d’être non seulement l’instrument d’illustres compositeurs, mais aussi un instrument privilégié par les amateurs et particulièrement les femmes, des musiciens et musiciennes peu présents dans l’historiographie du clavecin. Le projet implique le dépouillement de nombreux fonds manuscrits et l’étude de répertoires inédits (transcriptions et arrangements). Il s’articulera à une enquête sur les pédagogies en usage, en associant musicologie et anthropologie historique. Il sera mené en collaboration avec des musiciens et facteurs d’instruments.
Le projet s’articule autour de trois axes :
- Transcriptions, réductions pour clavier : fabrique de répertoires, élaboration d’idiomes instrumentaux, histoire du goût musical
- Enseignement et pratique du clavecin chez les amateurs. Le jeu du clavecin, une technique du corps.
- La place singulière des femmes dans l’histoire du clavecin français
Collaborations institutionnelles
Fondation Royaumont, IHRIM (Lyon), Projet ENCCRE, Centre de Musique Baroque de Versailles
Réalisations
– Séminaire Les Produits dérivés de l’opéra (XVIIe-XVIIIe siècles) organisé par Marie Demeilliez et Thomas Soury (univ. Lumière Lyon 2, IHRIM) : 6 rencontres en 2021-2022. Programme détaillé, résumés des séances et biographies des intervenants : https://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/rencontres/les-produits-derives-de-lopera-xviie-xviiie-siecles/
Un ouvrage issu de ce séminaire doit paraître en 2024 : Marie Demeilliez, Thomas Soury (dir.), Produits dérivés et économie des spectacles lyriques en France (xviie-xviiie siècles), Paris, Classiques-Garnier, European Drama and Performance Studies, 2024.
– Atelier de recherche et d’interprétation : L’Opéra au clavecin – Transcriptions et arrangements pour clavier (Fondation Royaumont, décembre 2022), avec Marie Demeilliez, Thomas Soury (univ. Lumière Lyon 2, IHRIM) et les clavecinistes Jean-Luc Ho et Olivier Fortin : https://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/rencontres/lopera-au-clavecin-xviie-xviiie-siecles/
Une émission radiophonique a été réalisée lors de cet atelier et diffusée en mars 2023 : https://metaclassique.com/metaclassique-216-transcrire/
– Journée d’étude : « Une histoire du clavecin au XXe siècle : hommage à Blandine Verlet », conçue par Marie Demeilliez, Jean-Luc Ho et Thomas Vernet (4 oct. 2021) : https://www.royaumont.com/clavecin-journee-dhommage-a-blandine-verlet/
– Edition critique des articles sur l’accompagnement sur la basse continue publiés dans l’Encyclopédie de Diderot, D’Alembert et Jaucourt, dans le cadre du projet ENCCRE : http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/
– Journée d’étude : La musique dans l’Édition numérique collaborative et critique de l’Encyclopédie (1751-1772), Lyon, déc. 2022, organisée par Marie Demeilliez et Thomas Soury : https://luhcie.univ-grenoble-alpes.fr/rencontres/la-musique-dans-ledition-numerique-collaborative-et-critique-de-lencyclopedie-1751-1772/
Organisation d’une table ronde à la 20th Biennial International Conference on Baroque Music (Genève, juin 2023) : Music in the Encyclopédie (1751-1772): The ENCCRE Project
– Atelier de recherche et d’interprétation : « ‘Nach französisher Art’ : la naissance du style français dans la musique allemande pour clavier » (Fondation Royaumont, décembre 2023), avec Marie Demeilliez, Louis Delpech (Hochschule für Musik und Theater de Hambourg) et le claveciniste Jean-Luc Ho : https://www.royaumont.com/centre-pour-les-artistes/les-formations-professionnelles/formations-pratiques-bibliotheques-et-ressources/atelier-naissance-du-style-francais-dans-la-musique-allemande-pour-clavier/
ETHIOKONGROME : Les chrétiens d’Éthiopie et de Kongo face à Rome : écrire une autre histoire des connexions entre l’Afrique et l’Europe (xve– xvie s.)
Projet financé par l’Agence nationale de la recherche (Identifiant : ANR-23-CE27-0024)
Pilotage : Olivia Adankpo-Labadie (UGA, LUHCIE) et José Rivair Macedo, historien (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Présentation du projet : Comparer deux royaumes africains et chrétiens connectés à Rome
Présentation du projet sur la plateforme Huma-Num
« La candidature à un financement ANR JCJC pour le programme intitulé ETHIOKONGROME a été préparée dans le cadre du projet émergent ETHIOKONGMED 2020-2023 (IRGA -Ecole française de Rome) ».
Qu’est-ce que Rome pour les chrétiens d’Éthiopie et du Kongo? Comment les élites de ces deux puissantes formations politiques d’Afrique sont-elles entrées en contact avec la capitale de la chrétienté latine depuis le xve siècle ? Comment, en retour, ces rencontres ont-elles contribué à transformer les pratiques du pouvoir et les expressions culturelles et religieuses en Éthiopie et au Kongo aux xve et xvie siècles ? Le projet ETHIOKONGROME entend répondre à ces questions essentielles, largement inexplorées, selon une approche comparatiste et pluridisciplinaire.
L’enquête historique proposée vise à comprendre quelles ont été les multiples voies empruntées par la rencontre entre l’Éthiopie, un ancien royaume chrétien de la Corne de l’Afrique, le Kongo, une formation politique de l’Afrique centrale en contact avec le catholicisme romain depuis la fin du xve siècle, et Rome, centre politique et urbain et capitale de la chrétienté latine.
Si les royaumes de Kongo et d’Éthiopie s’inscrivent dans des temporalités et des cadres géographiques très distincts, si la question de place de la traite des esclaves les sépare, ces deux États présentent d’étonnantes similarités à partir de la fin du xve siècle, puisqu’ils apparaissent comme des formations politiques puissantes et hiérarchisées dirigées par des élites chrétiennes, qui font du christianisme un instrument de leur pouvoir. Ces points de convergence dans leur organisation socio-politique et religieuse font aussi la singularité de l’Éthiopie et du Kongo dans l’histoire de l’Afrique pré-contemporaine.
Le projet ETHIOKONGROME part ainsi de l’hypothèse fondatrice suivante : Rome peut servir de miroir pour observer les transformations socio-politiques et religieuses que connaissent les royaumes d’Éthiopie et de Kongo au cours des xve et xvie siècles, et en discerner les similitudes et les dissemblances, et constituer un laboratoire d’analyse du catholicisme selon la perspective des Éthiopiens et des Kongos.
Cette enquête considère la période s’étendant des années 1480 à 1600 comme le moment décisif de la genèse des contacts avec Rome et de l’invention de nouvelles modalités de relations entre l’Éthiopie, Kongo et la papauté. Ces rencontres conduisent à l’évolution profonde de la spiritualité et de l’exercice du pouvoir en Éthiopie et au Kongo. Ces transformations sont caractérisées, d’une part, par l’affirmation et la reconfiguration du christianisme orthodoxe éthiopien ; et d’autre part, par l’invention du christianisme kongo. L’étude proposée entend ainsi évaluer le rôle et la place de ces deux puissances africaines en les plaçant résolument au centre des réflexions et non plus à la périphérie.
Le projet ETHIOKOGROME est coordonnée par Olivia Adankpo-Labadie et fédère une équipe internationale aux multiples compétences disciplinaires (histoire, histoire de l’Art, musicologie, philologie) et linguistiques.
Le projet est articulé autour de quatre axes de travail :
Axe 1 : inventorier et valoriser les « archives romaines de la rencontre »
Le premier volet des missions d’ETHIOKONGROME consiste à inventorier et à valoriser les fonds d’archives relatifs, d’une part, à la présence des Éthiopiens et des Kongos à Rome aux xve et xvie siècles, et d’autre part, aux contacts entre le Saint-Siège et les royaumes d’Éthiopie et de Kongo à cette période.
Axe 2 : Rome, atelier des savoirs sur l’Éthiopie et le Kongo
Le second volet du projet entend déterminer le rôle des Éthiopiens et des Kongos dans la fabrique des savoirs, la place occupée par Rome, envisagée ici conjointement comme espace urbain, centre de gravité du christianisme et pôle humaniste, dans la mise en forme et la diffusion de ces connaissances.
Axe 3 : Conversions, conversations et oppositions. Les Éthiopiens et les Kongos face au catholicisme
Le troisième axe de l’enquête entend analyser et comparer la pluralité des formes d’appropriation, de création et de réponses à l’égard du catholicisme romain élaborées par les élites politiques, les lettrés et les artistes éthiopiens et kongos. Il s’agira d’approfondir cette question en s’attachant à la démarche comparatiste.
Axe 4 : De l’Afrique à la Méditerranée, pouvoirs chrétiens connectés
Le quatrième volet du projet entend décrire et comparer les stratégies adoptées par les pouvoirs éthiopiens et kongos pour entrer en contact avec le Saint-Siège et leurs conséquences politiques, avec une attention particulière portée aux différentes ambassades qui ont eu lieu aux xve et xvie siècles entre ces trois puissances.
Collaborations : Olivia Adankpo-Labadie (UGA – LUHCIE), Gilles Bertrand (UGA – LUHCIE), Anne Damon-Guillot (Université Jean Monnet – Saint-Étienne), Cécile Fromont (Yale University), José Rivair Macedo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Marina de Mello e Souza (Universidade de São Paulo)
Équipe : Mathilde Alain (Centre for the Study of the Renaissance, Warwick), Carlos Almeida Centro de História da Universidade de Lisboa), Gilles Bertrand (UGA – LUHCIE), Brice Blanpain (Université Paris I – Panthéon Sorbonne), Anne Damon-Guillot (Université Jean Monnet – Saint-Etienne), Marie Demeilliez (UGA – LUHCIE), Cécile Fromont (Yale University), Gabriele Giacomazzi (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Damien Labadie (CNRS – CIHAM), José Rivair Macedo (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Méliné Mirguidtchian (INALCO), Gilles Montègre (UGA – LUHCIE), Thiago Sapede (Universidade Federal da Bahia)
Manifestations scientifiques :
Atelier international « Langues, textes, images et sons entre l’Éthiopie, le Kongo et Rome (1480 – 1630) », 20 & 21 juin 2024, salle 002 de la MACI, Université Grenoble Alpes
Manifestations passées :
Journée d’étude : Arts, christianisme et pouvoirs en contact (Éthiopie, Kongo et mondes méditerranéens, XIVe – XVIIe siècles)
Post-doctorante : Mathilde Alain, docteure en histoire
La juste mesure du luxe (Italie, XIIIe –XVIe siècle)
Pilotage : Ilaria Taddei
(Projet Institut Universitaire de France – IUF)
Résumé : Dans la continuité de mes travaux consacrés aux lois somptuaires, à la culture des consommations de luxe et à la vertu de la prudence, ce projet entend analyser les dispositifs législatifs qui, à partir du XIIIe siècle, à mesure que la richesse italienne croît et la demande des biens de luxe se dilate, produisent des jugements sur les objets, définissent la valeur des choses et le seuil moralement et socialement acceptable du luxe.
Dessiner l’Histoire (XIXe-XXIe siècles)
Pilotage : Sylvain Venayre
(Projet Institut Universitaire de France – IUF)
Résumé : Dans le prolongement de mon travail sur l’histoire des guerres lointaines au XIXe siècle, ce projet vise à mettre au jour et à analyser un corpus d’œuvres dessinées qui ont donné à voir, comprendre et ressentir les guerres menées loin de l’Europe entre 1830 et 1910. Il s’agit tout autant de contribuer à l’histoire des opinions publiques au temps de l’impérialisme qu’à l’histoire de l’illustration et à travailler, dans une perspective de recherche-action, à la définition de l’histoire dessinée.
Manifestations scientifiques :
20 mars 2024 : Guerre et dessin au XIXe siècle : une histoire de la circulation des émotions
10-11 Mars 2025 : Dessiner l’Histoire. Récits illustrés et bandes dessinées (XIXe-XXIe siècles)
30/03-01/04/2026 : Histoires nationales et récits dessinés (XIXe et XXIe siècle) : une perspective mondiale
VIMEAR (Vignes médiévales et antiques de Rome)
Pilotage : Clément Chillet et Cécile Troadec
(Initiatives de Recherche à Grenoble Alpes – IRGA)
Résumé
Le projet VIMEAR se place sur le champ de l’histoire urbaine et adopte une approche transpériode (entre Antiquité et Moyen Âge) et pluridisciplinaire (convoquant les méthodes de l’histoire, de l’économie du droit, de la géographie et de l’informatique). En effet, il s’inscrit dans les perspectives nouvelles ouvertes par la recherche récente en termes de reconstitution des paysages urbains ; d’étude des structures et des fondements juridiques des patrimoines fonciers ; d’histoire économique et sociale consacrée au marché de la terre. Son objet d’étude est la ville de Rome qui constitue un laboratoire unique du fait d’abord de la remarquable continuité d’aménagements urbains sur un même territoire, ensuite de la masse de documentation disponible sur un arc chronologique large et sans nombreuses solutions de continuité (de l’Antiquité à la période contemporaine).
Le projet prend pour point d’appui une spécificité du paysage urbain romain : les vineae (enclos maraîchers, propriétés des familles et institutions civiles et ecclésiastiques romaines, qui se situaient dans l’espace laissé vide par la contraction de l’espace urbain survenu à la fin de la période antique).
L’intérêt de ce point d’entrée tient aux caractéristiques de ces vineae :
- De superficie généralement réduite (en moyenne un demi-hectare), les vineae constituent un échelon particulièrement intéressant pour reconstituer à une échelle fine le maillage des propriétés urbaines.
- Elles sont très bien renseignées dans la documentation médiévale et moderne, en particulier notariée, car, du fait de leur prix modique, elles ont fait l’objet d’innombrables transactions. Ces traces documentaires offrent des informations sérielles très détaillées sur ces parcelles, ce qui doit permettre de reconstituer de larges pans des structures de la propriété foncière.
- Espaces non urbanisés, à la frontière entre habitat et grandes exploitations céréalières, ces enclos maraîchers sont d’une importance fondamentale pour l’approvisionnement de Rome en denrées alimentaires.
- Enfin, elles ont été les lieux de découverte de vestiges antiques, au cours des périodes médiévale et moderne. Ces objets, ensuite transférés et conservés dans des collections privées et publiques avec la mémoire du seul nom de leur lieu de découverte, sont aujourd’hui très difficiles à rattacher à un contexte urbain précis (et donc difficilement exploitables) étant donnée notre méconnaissance de la topographie des vineae.
– Collaborations :
Ecole française de Rome ; Roma Tre ; La Sapienza, Università di Roma Tor Vergata
– Réalisations prévues :
Il se déroulera selon trois axes de recherche :
Axe 1 – Croiser sources antiques et médiévales pour reconstituer le paysage de la Rome antique et médiévale
Axe 2 – Comprendre les origines des structures de la propriété foncière
Axe 3 – Analyser le fonctionnement du marché de la terre
Les travaux donneront lieu à l’élaboration d’une base de données collaborative pour l’exploitation des données, dont les résultats seront présentés lors d’une journée d’étude.
Res-Publica /République
Pilotage et/ou co-pilotage du programme : Clément Chillet, Marie-Claire Ferriès, Ilaria Taddei
Collaborations : MSH-Alpes, axe langages et politiques
Descriptif
Ce programme se donne pour objet l’étude de la Res publica et du bien commun dans le vocabulaire (emploi et remplois), les structures de pensée, les institutions, les processus de prise de décision, les modalités d’organisation de la communauté, son évolution politique dans les « républiques » de l’Antiquité et du Moyen-Âge. Le champ chronologique et géographique s’étend pour l’heure de la naissance de la république romaine à la fin du Moyen-Âge mais, dans une seconde phase, elle a vocation à aller jusqu’à la période contemporaine. Par le biais de l’historiographie, c’est aussi l’histoire de certaines actualisations de l’idée et de la pratique républicaine qui sera étudiée. Cette démarche s’ancre dans les champs de recherche de plusieurs collègues (C. Chillet, M. Ferries et I. Taddei) et il présente plusieurs points de convergence avec le programme (notamment Langages &politiques et des travaux déjà réalisés ou en cours.
Ce programme prévoit chaque année un séminaire qui s’organise autour de quatre séances aux thématiques fixes et de quelques conférences.
‘Les mots de la République‘ portant sur les thèmes de lexique politique de la Res Publica et des Républiques
‘Historiographie et actualité de la recherche’, portant sur l’analyse détaillée d’une publication récente et de ses résonnances historiographiques
‘La République en acte’ portant sur une étude de cas
‘Histoire-et-politique’ portant sur l’engagement intellectuel et l’engagement politique. Les études républicaines et les Républiques contemporaines
Réalisations :
23/11/2021 : Rem publicam constituere: le paradoxe d’une chose publique à (re)fonder ?
20-21/01/2022 : La politique est dans la place ! L’usage politique des places publiques
18/01/2023 : Les places publiques dans les Républiques italiennes
14/02/2024 : Les lieux de la politique dans la capitale d’un royaume : les Seggi à Naples au XVe siècle
14/03/2024 : Le consulat de Cicéron dans le débat politique de l’époque triumvirale
03/04/2024 : La virtus de C. Marius entre polémique politique et déformations historiographiques